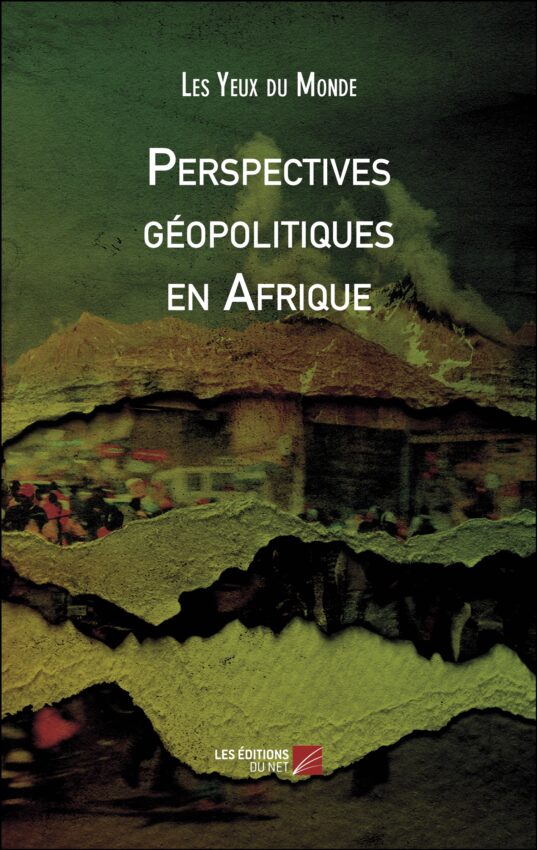PSU et deuxième gauche (1/4)

Au Congrès socialiste de Nantes en 1977, Michel Rocard distingue deux traditions politiques au sein de la gauche française. Un courant jacobin, centralisateur, étatique, nationaliste, protectionniste, qui prône donc un Etat fort et interventionniste. A l’opposé, un courant décentralisateur, régionaliste, attaché à l’autonomie et aux compétences des « collectivités de base », qui par opposition à la première est connue sous le nom de « deuxième gauche ». Si ce second courant se caractérise par sa grande hétérogénéité, le Parti Socialiste Unifié (PSU) aura été, tout au long de son existence, la cheville ouvrière de cette nouvelle galaxie de gauche, son aboutissement le plus institutionnalisé. Tour d’horizon en trois temps.
Un héritage catholique, point de départ d’un rapport distancié à l’Etat républicain
La deuxième gauche, cadre idéologique dans lequel s’inscrit le PSU, trouve ses origines en 1958 dans le rejet de la politique algérienne de la SFIO molletiste. Cependant, l’épisode algérien serait plutôt à considérer comme la concrétion finale, l’aboutissement d’une dynamique récemment accélérée. Il apparaît en effet que parmi les forces vives militantes et pensantes du PSU, des mouvements chrétiens, notamment le groupe « Reconstruction » au sein de la CFDT, mais aussi des groupes militants, unis derrière la bannière UGS à partir de 1957, ont joué un rôle de premier ordre.
Vincent Duclert fait ainsi remonter la généalogie de la deuxième gauche à la fin du XIXème et au début du XXème, qui voient s’affirmer un catholicisme social et libéral, affirmant son attachement à la République et à ses valeurs de défense du citoyen, notamment au moment de l’affaire Dreyfus. Un mouvement qui connaît quelques grandes figures comme Paul Viollet et son Comité catholique pour la défense du droit, ou encore Marc Sangnier et les Sillons diocésaux puis plus largement son action politique au sein de la Jeune République. Il s’agit d’un catholicisme militant qui se caractérise également par une fort attachement et une audience certaine à la population étudiante, ce qui se concrétise par d’intenses relations avec la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC).
Au-delà de l’attachement aux valeurs de la République et à la défense des droits individuels s’affirme déjà ici une pensée distincte tant du socialisme de la SFIO naissante que de la CGT anarcho-syndicaliste. Parce que mouvements religieux, ils ont vis-à-vis de la République une distanciation qui les éloigne du jaurésisme, mais qui n’en n’est pas moins radicalement distincte de celle développée par le marxisme guesdiste. Institutionnellement, cela se traduit par une méfiance vis-à-vis de l’Etat et un intérêt singulier pour les « corps intermédiaires », tant à travers les Sillons diocésaux que via l’intérêt porté aux associations étudiantes. Sociologiquement aussi, ces mouvement reposent déjà sur des classes sociales plus éclairées et éduquées que la moyenne nationale, trait qui caractérise également le PSU, au moins dans ses dix premières années.
Sous la IVème République, cette tendance s’ouvre à un horizon plus laïque. Un grand courant réformiste s’affirme, qui regroupe une minorité de la CFTC ainsi que divers groupuscules derrière l’appellation de « nouvelles gauches » regroupent des humanistes, néo-communistes, trotskistes ou encore des radicaux progressistes. L’Union progressiste constitue alors une tentative d’émanation politique, mais le courant pèse bien plus dans le débat public, par l’intermédiaire de son organe de presse qu’est France Observateur mais aussi par le soutien que lui affichent Le Monde de Beuve-Méry ou l’Express de Schreber. Déjà la dichotomie est palpable entre la base militante restreinte du mouvement, restreinte, et l’écho certain que connaissent ses idées au sein du débat public.
Un comité de liaison est créé dès 1954 pour lier l’ensemble de ces mouvements aux mendesistes et à des étudiants de l’UNEF. C’est ainsi qu’en décembre 1957 ils s’unissent ensemble sous le bannière de l’Union de la gauche socialiste (UGS), proche des idées de Mendès-France mais aussi de socialistes réformateurs comme Philip ou Savary.
L’engagement contre la guerre d’Algérie, réquisitoire contre la « première gauche »
Le refus de la guerre d’Algérie constitue l’expérience fondatrice de la deuxième gauche, tant cet épisode est l’occasion de s’affirmer contre la gauche « institutionnelle », ancrée dans une conception nationale qui légitimisme la raison d’Etat et pousse à l’esprit unitaire en temps de crise. C’est ainsi le moment de l’affirmation d’un profond anti-totalitarisme (rapport Rocard sur les camps de populations musulmanes). Pour cette nouvelle gauche, le conflit algérien révèle l’archaïsme de la vieille garde de la SFIO, mais aussi des communistes et des radicaux : la fuite en avant de Mollet démontre le besoin de remplacer le marxisme et la nationalisme par un réformisme démocratique éclairé.
En 1958, la dynamique des idées réformistes, exacerbée par l’épisode algérien, pousse ainsi des dissidents de la SFIO a créer, le 8 novembre, le Parti Socialité Autonome (PSA) – SFIO dont Rocard, Bérégovoy, Savary, Dépreux et Verdier sont les principaux animateurs. Dès lors, si le PSA s’inscrit initialement dans l’opposition au gaullisme pour fédérer la galaxie des nouvelles gauches dans la dénonciation de la guerre d’Algérie, ce positionnement inaugure un anti-gaullisme plus durable et dépassant la seule question algérienne, fondé sur un rejet catégorique de la raison d’Etat et de l’arbitraire qu’elle représente pour eux. Dans les faits, des nuances existent cependant, à l’image de Rocard, parallèlement membre du club Jean Moulin, qui critique le gaullisme d’une manière moins virulente que constructive.
Dès l’été 59, des pourparlers sont organisés avec les différents mouvements de gauche réformiste, l’UGS notamment, mais aussi une fraction de communistes réunis autour de la revue Tribune socialiste. Unis dans la volonté de proposer une « troisième voie » en vue d’une réforme socialiste du capitalisme, les tractations aboutissent le 3 avril 1960 avec la création du Parti Socialiste Unifié (PSU). En 1962, le parti revendique 15 000 membres.
La gauche paraît alors largement divisée entre une SFIO molletiste affaiblie et un PCF en perte de vitesse et enregistre une sévère défaite aux législatives de 1962. Dans ce paysage, le PSU s’oppose radicalement au ralliement gaulliste de Mollet et est alors perçu comme un facteur de division supplémentaire, situé à l’extrême gauche de l’échiquier politique. Il prône la stratégie de « front socialiste », adoptée au Ier Congrès ordinaire du parti en mars 1961, et qui sous-tend une volonté de bousculer l’acception classique du parti politique, désormais compris comme une plate-forme de convergence de différentes entités (associations étudiantes, syndicales, religieuses…).